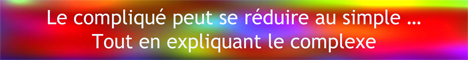Agnostiques et athées
- Détails
- Version n° 6 du 20-10-2024
J'ai l'impression de connaître plus d'indifférents et d'agnostiques déniant à toutes religions de détenir LA vérité, que d'athées niant tout créateur.
Il faut dire que jusqu'à Vatican II, le catholicisme n'a pas trop donné l'exemple de la douceur (intolérance, guerres de conquête de l'islam, croisades, pogroms, inquisition, … ).
Une nuance : la volonté d'épanouir sa personnalité, son individualité, courante dans nos pays (fruit de l'éducation croissante) se réalise dans une démarche d'autonomie (pas d'indépendance : il faut être réaliste !) qui peut ne prendre en compte que ses proches. C'est un individualisme pas tout à fait universel !
Je me demande, parmi cette majorité qui nous entoure et au sein de laquelle l'Esprit souffle aussi, quelle est la parcelle nouvelle de vérité à découvrir …
Croyances
- Détails
- Version n° 3 du 14-10-2024
Il est des thèmes qui relèvent des capacités de notre conscience et de notre intelligence, de se poser des questions sans réponse évidente. Même en posant des hypothèses de départ plausibles, le raisonnement peut ne conduire à aucune conclusion claire : il reste une part de mystère à laquelle les croyances tentent d'apporter des réponses.
Parmi ces croyances, certaines sont illogiques parce que insuffisamment réfléchies : il faut les éliminer.
L'hypothèse du Big Bang se développant selon les lois de la physique paraît juste puisque les conséquences sont vérifiables, mais cela ne dit rien de sa génération, de son origine … en somme d'où vient la création ? Les deux hypothèses les plus fréquentes sont un Dieu ou le néant, mais dans un cas comme dans l'autre, on n'a fait que repousser la question, car d'où émergent alors Dieu et le Néant ? De fait, s'ils sont l'un ou l'autre créateur … il faut les admettre incréés : c'est tout aussi inéluctable qu'incompréhensible. On est face à un mystère qui conduit beaucoup à ne pas y penser (les indifférents), d'autres à ne pas trancher (les agnostiques) et un dernier groupe à croire en un Dieu (les croyants) ou au Néant (les athées). A noter qu'accepter, comme ces derniers, une création sans créateur me paraît d'une logique qui m'échappe. Pour les croyants, ne pas comprendre n'est pas forcément illogique !
Admettre un créateur est logique même si on ne peut imaginer comment il s'est créé. On peut alors affirmer qu'il a une intelligence très supérieure pour avoir imaginé un système, aussi simple qu'une poignée de particules gouvernées par quelques lois très simples, pilotant toute l'évolution de l'univers pendant des milliards d'années et conduisant à l'apparition de la vie, invraisemblable château de cartes ayant fait apparaître la sensation puis la sensibilité, les sentiments et la compréhension avant la conscience accompagnée du couple du bien et du mal.
On ne peut pas en dire beaucoup plus, mais on peut continuer de poser des hypothèses … S'il est Aimant, il est logique qu'il aime sa fantastique création et dans le cas de la créature consciente, parce qu'il n'y a pas d'amour sans respect de la liberté de l'autre qui doit donc pouvoir se trouver à choisir entre des options tentantes, cela l'oblige à lui donner la liberté de conscience et donc la possibilité de faire le mal … ce que l'expérience vérifie.
Des religions
- Détails
- Version n° 9 du 20-10-2024
La théologie se préoccupe des thèmes qui concernent la divinité. Les nombreuses interrogations qu'elle étudie sont souvent (toujours ?) du type {tooltip}indécidable{end-texte} Une déclaration qui est indémontrable et irréfutable est dite indécidable.{en-tooltip}.
Chaque groupe humain va développer sa religion : parmi les nombreuses réponses que l'on peut imaginer à ces questions existentielles, certaines vont être sélectionnées d'une manière plus ou moins réfléchies et devenir des croyances.
Leur ensemble doit former un jeu cohérent de propositions dont elle va penser et affirmer qu'elles sont la vérité : ses dogmes.
Toute question dont la réponse est univoque n'a aucune raison d'y figurer. Toute affirmation dogmatique doit être du type indécidable sinon elle enfonce une porte ouverte !
Chaque religion en déduira un jeu de pratiques à observer pour satisfaire la divinité.
Une difficulté surgit lorsqu'une d'elles, par la suite, trouve une explication qui l'infirme (par ex. : la Terre, centre de l'Univers confronté à sa position de simple satellite du Soleil ou la vision d'un monde statique immuable face à la théorie de l'évolution) : il faut négocier le virage en bousculant la confortable tradition !
Pour éviter une telle situation, une sage religion ne devrait exprimer que des convictions compatibles avec les connaissances du moment et non des dogmes immuables.
Israël a perçu que Dieu est unique et créateur,
le bouddhisme prône la compassion qui console,
l'islam, la miséricorde qui pardonne,
le christianisme adopte tout cela
en y rajoutant la joie d'être divinisé en unissant tous les hommes à Dieu dans l'Amour.
Religion et foi
- Détails
- Version n° 2 du 19-03-2024
Il me semble que le christianisme doit être tout à la fois une foi et une pratique.
Pour ceux qui n'ont qu'une conscience peu claire des mystères de Dieu (les petits et les périphéries du pape François), la religion, avec ses rites est nécessaire pour leur permettre d'exprimer ce qu'ils ressentent plus ou moins confusément (ce qui ne veut pas dire que ces rites ne gagneraient pas à se débarrasser des mises en scène inspirées des cérémonies impériales des premiers siècles et royales du XVIe).
Pour ceux qui ont une pensée plus élaborée (20% des jeunes français suivent des études supérieures), ce sont les bases de la foi qui doivent être solides et là, c'est la cohérence des dogmes, en eux-mêmes et entre eux vis-à-vis de l'état des connaissances du XXIe, qui doit être revisitée pour être plausible. La difficulté, c'est que l'on est alors dans le domaine de la conviction et non de la (sécurisante) certitude.
Religion et science
- Détails
- Version n° 3 du 20-03-2024
Lorsqu'il y a des points de vue différents entre science et religion (création du monde, apparition de l'homme, âme immortelle, miracles, Eden, … ), on peut distinguer différents cas :
- La science a accumulé nombre d'indices cohérents avec son hypothèse : la religion doit revoir sa manière de comprendre les choses. Cela me paraît être le cas pour la création du monde à partir du Big Bang plutôt que selon la Genèse ou l'Eden.
- La science ne trouve pas cohérent avec une tendance générale de la nature une croyance, mais n'a pas d'autre argument de penser qu'elle est peu plausible comme une intervention de Dieu dans l'histoire en violant les lois de la nature (création soudaine de l'homme puis de la femme, conception virginale de Jésus, multiplication des pains, … ).
Il serait sage que la science maintienne son point de vue en reconnaissant que ce n'est pas une affirmation, mais une croyance contestable. De son côté, la religion devrait laisser le doute flotter en faisant une simple préférence de sa croyance.
- Des scientifiques contestent des croyances, mais la science n'a aucune expérience du sujet ou ne sait ni expliquer le phénomène ni le réfuter (immortalité de l'âme, des guérisons miraculeuses, revitalisation de Lazare, libre arbitre, … ), la science doit se taire et la religion admettre que c'est une conviction qui peut ne pas être partagée par tous.
Les scientifiques qui sont un peu philosophes ont la prudence face à un phénomène, soit d'avouer qu'ils ne savent comment l'expliquer, soit de préciser que la théorie du moment qui en décortique le mécanisme peut évoluer si un fait nouveau la remet en cause.
Les théologiens, souvent à partir d'indices tenus, en déduisent des conclusions plausibles qui sont trop souvent transformées en dogmes certains que l'on ne peut remettre en cause … ce qui me paraît une entrave à la liberté de conscience et même à la logique. Pourquoi l'église ne se contente-t-elle pas d'exprimer le point de sa compréhension du moment ?